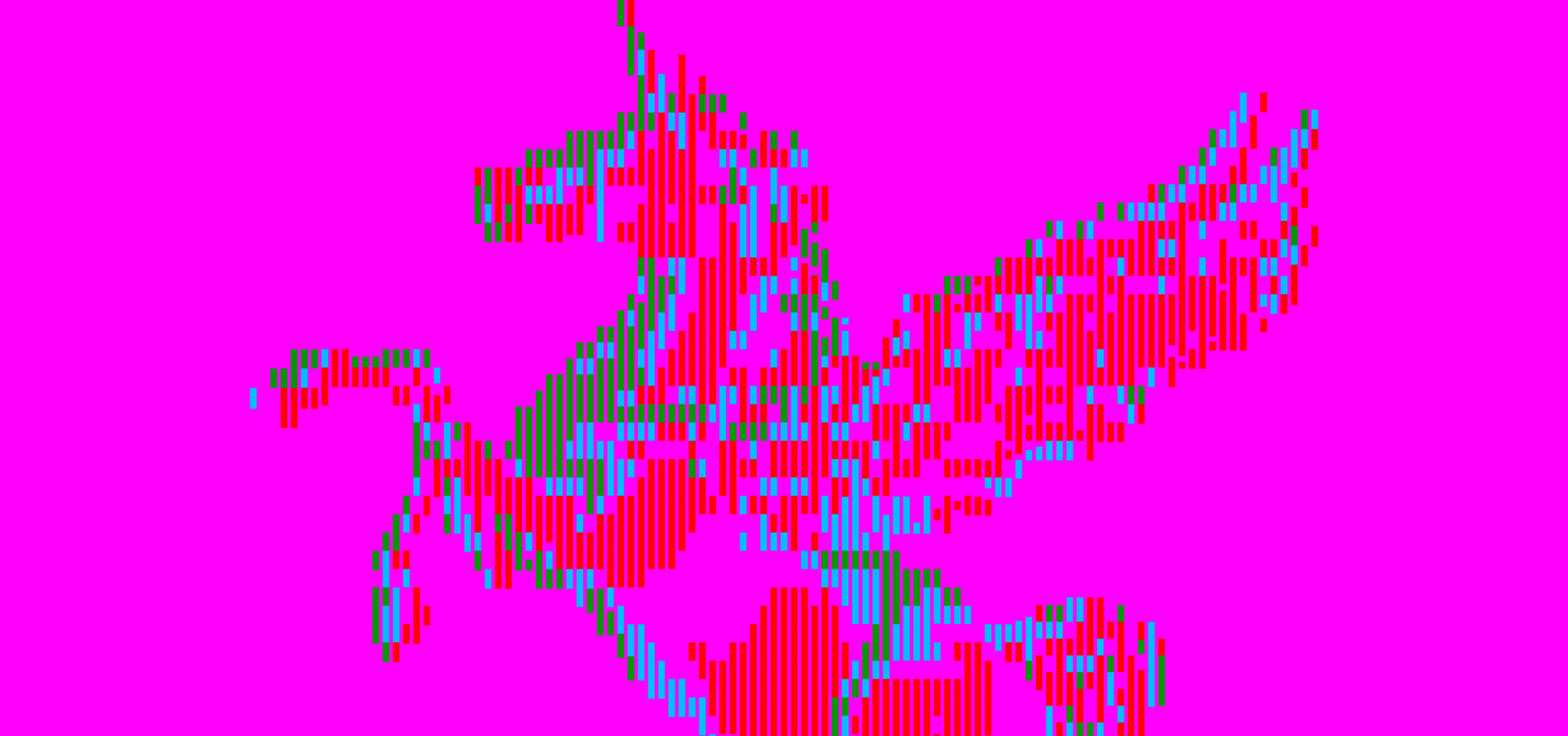
danse
+ théâtre
Festival TransAmériques
19e édition
22 mai
au 5 juin 2025
Tous nos spectacles sont en vente !
Forfait Découverte
2 spectacles
pour 85 $
L'offre s'applique à l'achat d'un billet au tarif régulier pour deux spectacles parmi Taverna Miresia, Shiraz et Hatched Ensemble.
4 spectacles et +
20 %
de rabais sur le tarif régulier
Sélectionnez un minimum de 4 spectacles différents au tarif régulier pour avoir accès aux tarifs forfaits.



















