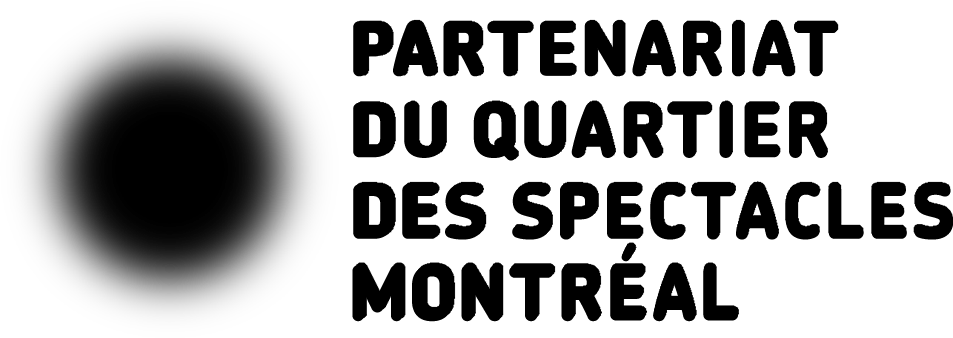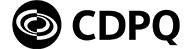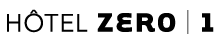Pourquoi est-il particulièrement difficile pour un b-boy ou une b-girl de faire face au vieillissement du corps ?
C’est une condition humaine que l’on partage tous, sauf que c’est particulier pour un b-boy ou une b-girl parce que, sans le vouloir, leur identité s’est formée autour de leurs capacités physiques. C’est aussi une question de perception des autres, laquelle a une lourde influence sur le regard qu’on porte sur soi. Je dis souvent que lorsqu’on commence une carrière de break, on signe un contrat qui nous confère des pouvoirs de superhéros : on pourra accomplir toutes sortes de prouesses et inspirer l’admiration des autres, sauf qu’en petits caractères sur le contrat, il est aussi écrit que ça ne durera pas. Les pouvoirs nous seront retirés rapidement. Quand ça arrive, c’est un choc.
De mon côté, j’ai été épargné : l’identité de « Crazy Smooth » est rattachée à une forme de présence plutôt qu’à mes habiletés physiques. Mais ces réflexions m’ont souvent été rapportées par des membres de la communauté. Il existe un certain fatalisme, une honte associée au fait de ne plus pouvoir répondre aux attentes. In My Body offre une multitude de perceptions par rapport au vieillissement du corps : tout part de mon expérience personnelle, mais il s’agit aussi d’une expérience commune.
Vous rassemblez trois générations d’interprètes sur scène. Qu’est-ce que chacune de ces générations apporte comme couleur à la dynamique de groupe ?
Il y a d’abord les « OG » (original generation), que l’on appelle aussi les « ancien·ne·s » ou les « pionnier·ère·s » sans qui c’est un cirque. Leur présence nous guide. Ce sont nos « bibliothèques vivantes ». Leur expérience a une valeur qu’on ne peut pas quantifier. On danse différemment quand iels sont là. À l’autre bout du spectre, les jeunes apportent, à l’image de notre société, une forme d’espoir : les possibilités sont infinies. Les contraintes ou les responsabilités ne les affectent pas. La vivacité et l’énergie qu’ils infusent au groupe sont essentielles. La street dance, c’est une culture de jeunes. Nous avons besoin d’eux.
Enfin, il y a ma génération, celle de l’entre-deux. Nous faisons le pont entre les jeunes et les anciens. Sans nous, il y a des frictions. On assure à nos pionniers et pionnières que les acquis seront préservés, et aux jeunes qu’ils seront écoutés et compris, tout en les ramenant à l’ordre. C’est un écosystème que l’on trouve partout dans le monde des danses urbaines et que j’ai voulu transposer sur scène. Aucun groupe ne peut exister sans l’autre.
Comment conserver les codes propres aux danses urbaines, tels que la force, l’intensité et la puissance, tout en étant dans l’expression d’une certaine vulnérabilité ?
C’est un grand tabou. Ça fait partie de la culture hip-hop — tout comme en street dance — de s’afficher comme étant le meilleur, le plus fort, le plus riche. Les artistes issus de cette culture ne parlent pas des choses de la vie qui nous rendent vulnérables. C’est la même chose pour les danseurs et danseuses. Le mouvement devient difficile en vieillissant : c’est tout simplement la vie qui suit son cours, mais on n’en parle pas. J’ai voulu exposer ce tabou pour éviter de brosser un portrait de la perfection.
Dans le spectacle, on accomplit des prouesses incroyables sur une musique… puis, elle s’arrête. On entend alors l’exigence physique fournie par l’interprète, on révèle les luttes internes qui l’assaillent à tout moment. Les danseurs et danseuses font la guerre à leurs membres, leurs articulations. Il y a une beauté qui se crée au rythme du contact et de la respiration de l’interprète qui se bat avec son corps pour maintenir son niveau d’intensité. La vulnérabilité, la révélation au grand jour de ce qui se passe « in my body », elle est là.
Que signifie le mot ghanéen « sankofa », central à la trame narrative du spectacle ?
Sankofa, c’est la transmission de la tradition. Littéralement, le mot se traduit par « chercher dans le passé » en Twi, dialecte parlé au Ghana. On s’appuie sur les épaules de nos ancêtres, sur leurs acquis, pour bâtir la suite. C’est la seule manière de maintenir un écosystème en harmonie. Nul n’échappe à la friction de vieillir. Sankofa, c’est aussi l’acceptation. Accepter de vieillir amène une certaine paix intérieure. C’est une forme de liberté.
Un de mes mentors, Tedd Robinson, m’a raconté la métaphore du pianiste. Au début, le pianiste lit ses notes, puis, au fur et à mesure, il oublie sa partition et ne fait que jouer. Cette fréquence, cet état d’être où l’on joue sans réfléchir, c’est celui du moment présent. C’est aussi ce que j’appelle le « izm », d’où le nom de ma compagnie, Bboyizm. J’aspire toujours à cet état d’être ultime.