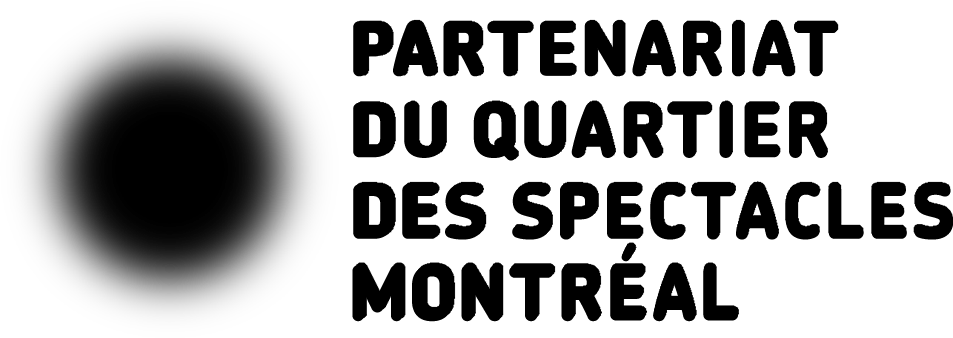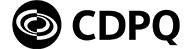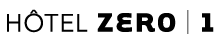Vos spectacles ont souvent comme moteur l’activité fourmillante d’un lieu précis. Dans LACRIMA, c’est l’atelier de couture, où s’agitent des mains expertes. Pourquoi ce lieu de travail vous fascine-t-il ?
En réalité, c’est la première fois que l’un de mes spectacles ne se déroule pas dans un seul lieu, mais dans trois : un atelier de haute couture à Paris, un atelier de dentelles à Alençon et un atelier de broderie à Mumbai. Ce qui m’a tout de suite intéressée, c’est le savoir-faire qui relie les personnages. Habituellement, c’est un lieu qui permet de réunir des gens dans mes pièces, mais ici, c’est l’ouvrage — la robe — qui devient l’élément central. Cette robe, très visible, comme celles de Kate Middleton ou de Lady Di, contraste avec l’invisibilité des personnes qui la créent, et c’est cet écart qui m’a fascinée. Mes spectacles ont toujours été motivés par l’idée de communauté, de ce qui unit les gens. Que ce soit un restaurant vietnamien, la colonisation française ou une robe de mariée, il s’agit de raconter plusieurs vies. Aujourd’hui, il est difficile de raconter notre monde depuis un seul point de vue.
Pourquoi le théâtre est-il, selon vous, l’endroit idéal pour donner une existence aux personnes dans l’ombre ?
Le théâtre a ignoré tant de gens pendant des années ! Je n’ai pas un radar inné pour débusquer les histoires non racontées, mais j’aime découvrir ces récits. J’ai envie d’entendre et de voir ce qui est resté secret. Le secret est souvent lié à la violence. Dans le cas de Marion, ce personnage du spectacle qui est victime de violences conjugales, le secret permet à cette violence de perdurer. C’est une question politique : pourquoi certains secrets restent-ils cachés, et que protège-t-on en les gardant ? Par exemple, pendant des années, la fabrication des broderies en Inde était gardée secrète, car elle soulevait des questions sur les inégalités économiques et coloniales. Le secret devient un moteur narratif et un révélateur de tensions sociales. J’entrecroise ces différentes toiles à travers le principe du récit choral. Il n’y a jamais une seule histoire, plutôt une dramaturgie qui rebondit sur plusieurs récits.
Cette choralité est un choix politique pour vous, permettant de parler de la société dans sa diversité et ses tensions ?
Exactement. À travers les logiques du monde du travail qui sont observées, et le surgissement d’histoires intimes et de secrets, LACRIMA parle de domination : celle du Nord sur le Sud, celle d’un patron sur un employé, d’un homme sur une femme, ou d’une classe privilégiée sur une classe populaire. Mais, ce qui est le plus important pour moi, c’est de montrer que ces victimes ont aussi une puissance : celle de leur savoir-faire. Leur force ne les sauvera pas nécessairement, mais elle leur donne une dignité, la capacité de participer à la beauté du monde. Au début, je voulais écrire uniquement sur un groupe de femmes, après avoir participé à des groupes de parole de femmes victimes de violences conjugales. Je me suis tournée vers le monde de la couture, mais en découvrant que les broderies étaient réalisées par des hommes musulmans en Inde, cela a bouleversé mon projet. Il m’a semblé impossible de ne pas inclure cette réalité masculine, et cela m’a permis d’explorer des questions plus larges, comme le néocolonialisme.
En processus de création, votre approche est celle d’une documentariste, puis vous basculez vers une écriture qui se saisit du réel, mais y greffe de la fiction et du poétique. Quel est votre rapport au réalisme et à la représentation du réel ?
Je ne sépare jamais vraiment la documentation de la fiction. Quand je rencontre des personnes, des brodeurs ou des dentellières, cela muscle surtout mon imaginaire. Je ne pourrais jamais faire de théâtre documentaire pur ; je suis toujours en train de transformer la réalité en fiction. Mais il est vrai que l’un de mes principaux soucis, c’est que l’auditoire croie à ce qu’elle voit. Je fais pour cette raison un théâtre très minutieux et très attentif aux détails. Mon défi, c’est d’amener les situations à un point où elles deviennent incroyables tout en faisant en sorte que l’on continue à y croire. Dans LACRIMA, quand je demande à Maud, qui joue Marion, de poser la main sur le mannequin ou de placer du tissu ; quand je demande au brodeur de regarder les perles, c’est pour que le public croit aux personnages. Une fois qu’il y croit, on peut l’entraîner dans n’importe quelle histoire.
La scénographie, entre réalisme et artifice, est un autre moyen d’y arriver. J’aime beaucoup citer une anecdote célèbre au sujet de Godard, qui, sur un tournage, demande à l’accessoiriste si telle armoire contient du linge. Même si le contenu de l’armoire n’est jamais montré à l’écran, Godard se dit que le spectateur peut sentir si elle est vide ou pleine. J’utilise aussi la vidéo, avec des effets split screen, un peu comme dans la série 24h Chrono, pour montrer simultanément ce qui se passe à Mumbai, à Alençon et à Paris. Cela crée un suspense, mais cela permet aussi de zoomer sur des détails de la couture, invisibles depuis la scène, pour révéler toute leur beauté.
On vous a souvent associée à Wajdi Mouawad, Robert Lepage et Ariane Mouchkine. Pouvez-vous parler de leur influence sur votre travail, notamment le rapport à l’émotion ?
Je connais moins bien le travail de Robert Lepage, mais je connais bien celui de Wajdi Mouawad. Le premier spectacle que j’ai vu de Wajdi Mouawad était Forêts. J’étais étudiante en théâtre à l’époque, et ça a été un choc. Il renouait avec deux choses fondamentales pour moi : l’émotion et la possibilité de raconter des histoires au-delà des frontières.
En France, à ce moment-là, l’émotion était une notion complexe, presque frustrée. Wajdi Mouawad a ramené cette idée que le théâtre peut susciter de fortes émotions. Ce spectacle m’a aussi montré qu’on pouvait raconter des histoires d’un bout à l’autre du monde, d’un lieu à un autre, au lieu de rester enfermé dans un seul espace. Pour moi, en tant que fille d’immigrés, c’était essentiel. Ma mère est vietnamienne, mon père était juif pied-noir, et j’ai grandi en Provence. Il me semblait impossible de raconter le monde uniquement à partir de mon village natal. Wajdi Mouawad m’a libérée de cette contrainte, en me montrant qu’on pouvait aller ailleurs pour mieux raconter ici.