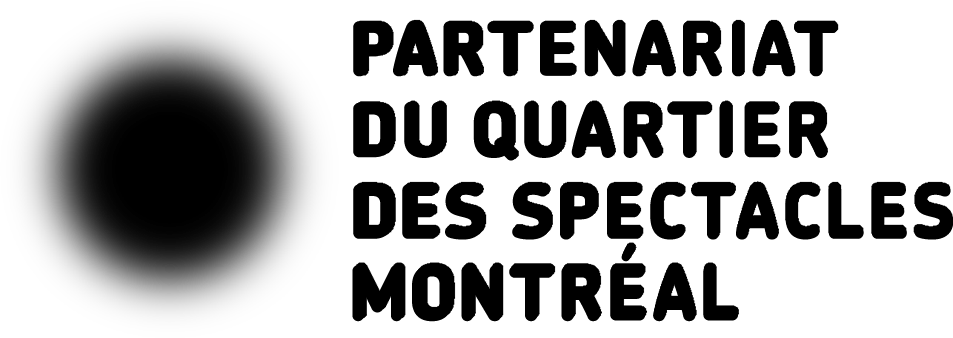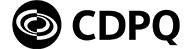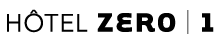Dans Cria, les accents plus traditionnels — samba ou capoeira — se frottent à des mouvements grappillés au hip-hop, au break, au voguing et j’en passe, avec une grande sophistication. Quelles sont les particularités de ces danses, le passinho, et de son dérivé, la dancinha, qui vous ont attirée ?
En 2014, lorsque le festival de danse Panorama m’a confié le choix d’un style de danse urbaine pour mener une recherche avec de jeunes danseurs, j’ai choisi le passinho, un tout nouveau style très technique, que j’avais vu passer sur Internet et qui me plaisait beaucoup. J’ai fait des auditions, et notre petite expérience a miraculeusement donné un spectacle : SUAVE.
J’avais déjà travaillé avec des danseurs de hip-hop, de krump, de popping.Le passinho est complètement différent et j’adore la musique funk.
Les danseurs empruntent au hip-hop avec désinvolture et inventent sans cesse de nouveaux mouvements. Il y a beaucoup de discrimination autour de ce genre musical et de cette danse, souvent associés aux trafiquants de drogue et à la violence, notamment la violence policière très présente dans les favelas.
L’environnement où naissent ces danses est très complexe. Les préjugés sont nombreux, tenaces. Des guerres brutales font rage au sein des favelas.
Des danses indigènes comme le passinho et la dancinha arrivent pourtant à relier certaines d’entre elles, à faire tomber les barrières. Les jeunes danseurs circulent librement. L’art arrive à connecter ces bidonvilles en colère.
Vous avez déjà dit ne pas chercher la virtuosité et les prouesses formelles. Or, dans Cria, la nature spectaculaire de certaines figures semble être une source d’affirmation importante pour les danseurs. D’où viennent ces coups d’éclat ?
Mon apport consiste à construire un monde où le langage et la technique des danseurs puissent exister et se déployer. Si l’un d’entre eux s’engage dans des figures difficiles ou virtuoses, c’est parce qu’il le souhaite. Ils sont les inventeurs du passinho, ils en détiennent les codes.
Ils en éprouvent les pas, les mouvements dans d’autres espaces, à l’intérieur de la favela. Sur la scène bien sûr, ces figures prennent une autre signification.
Pensons par exemple au solo de Mayla, qui fait tourbillonner ses cheveux. Au fil des représentations, avec l’enthousiasme du public, ce solo prend de l’envergure. Elle est maître de ce segment et de sa durée. La danse des cheveux de Mayla devient le symptôme d’une reconquête de l’espace par cette artiste de la communauté LGBTIQ+.
Cria est traversé par une grande liberté formelle, une sensualité et une énergie qui ouvrent le champ des significations. Mais retentissent soudain des coups de feu dans une scène de violence explicite, sans ambivalence. Cette irruption s’est-elle imposée ?
Cette réalité est très importante. Ces interprètes ne peuvent faire abstraction de la violence car elle fait partie de leur vie à chaque instant. Rester en vie est l’enjeu de leur travail. Plusieurs amis ou complices qui dansaient avec eux sont morts.
C’est un sujet difficile à aborder. Pendant le processus de création, nous avons beaucoup improvisé : danse, théâtre, prise de parole. La violence resurgissait à tous les tournants, d’une manière narrative, frontale.
Pour eux, tout est lié : la vie, la danse, la violence, la mort. C’est dommage que nous ne puissions pas faire une pièce sans évoquer cette violence, sans la faire apparaître.
Une solidarité, une fraternité et une tendresse entre les danseurs masculins émanent de Cria, particulièrement dans le duo final. Comment avez-vous abordé cette relation, à rebours des stéréotypes masculins qui circulent au Brésil ?
J’avais cette scène à l’esprit avant même de commencer la pièce. Le processus créatif était un prétexte pour développer ce type de mouvements, de sensations. Je suis devenue maman peu de temps avant que nous entamions le travail. La naissance de mon fils était vive à mon esprit.
Certains danseurs du groupe sont pères, chacun d’entre eux — en particulier les hommes — se sent connecté à la question de la paternité.Dans les favelas, les foyers sans homme sont nombreux, comme les familles sans père. Les hommes meurent très jeunes ou n’arrivent pas à fonctionner dans la structure familiale.
J’ai cherché comment mettre en relation ces enjeux sensoriels avec la violence de leur environnement — la drogue, les arrestations, la prison, la mort.
Depuis le début du travail, les danseurs ont apprivoisé le toucher, ils se respectent et intègrent leurs différences. Cette expérience sensible appartient à un monde différent. Au Brésil, depuis quelques années, on ne parle que de féminisme sans jamais en évoquer les raisons. Qu’est-il arrivé aux hommes ? D’où leur vient cette violence qui se concentre en eux ?
Il me semble que si les hommes peuvent se toucher, faire face à la part homosexuelle qui les habite et élever des enfants, jamais ils ne manqueront de respect aux femmes.