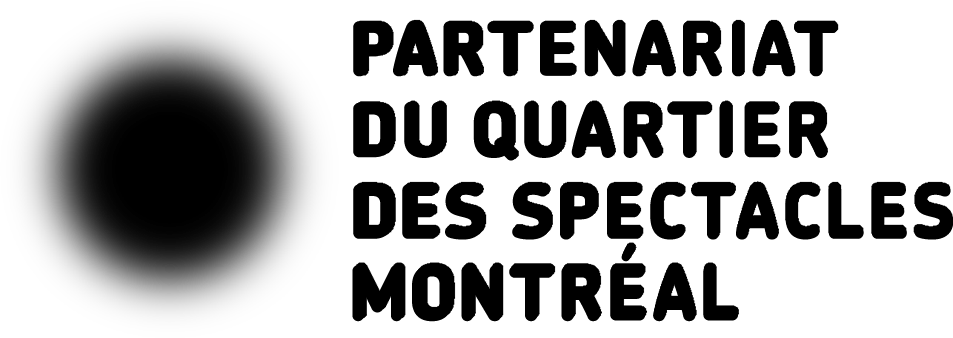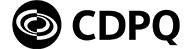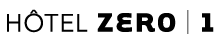Qu’est-ce qui a déclenché cette pièce ?
Bien avant de commencer Bronx Gothic, je réfléchissais beaucoup à la question de la vie intérieure et à la manière dont la mémoire nous construit. Comment les autres personnes vivent-elles dans nos corps, nous parlent, laissent des traces, nous font tenir debout ou chuter ? Quand des événements enterrés émergent à nouveau, qu’est-ce que cela suscite ? J’étais alors enceinte de ma fille. Je me suis mise à penser à ce qu’était l’enfance des petites filles noires, à la façon dont elles sont très tôt à la fois sexualisées, ignorées et isolées.
C’est une véritable culture de l’agression où elles sont considérées soit comme déviantes sexuellement, soit permissives ou corrompues. Le langage n’est ni remis en question ni critiqué. Je me suis rendu compte à quel point la violence et la sexualité étaient enchevêtrées. J’ai pris conscience du manque d’espace pour les petites filles pour explorer leur sexualité sans qu’elles soient punies ou reléguées dans un espace de déviance et de morale. Je pensais aux filles que j’avais connues et j’ai commencé à écrire des lettres inspirées par celles que nous nous échangions et par la manière dont nous nous racontions nos secrets.
.
Vous avez une pratique artistique transversale. Est-ce que le mélange des arts est nécessaire pour aborder certaines réflexions, problématiques ou thématiques ?
Le monde contemporain, la danse et le théâtre contemporains rendent visibles les personnes blanches et majoritairement cisgenres dont les modèles de corps imposent une certaine idée de la neutralité, de la pureté. Les corps du colonialisme et de la suprématie blanche servent une sorte d’archétype universel et excluent les corps de couleurs et d’autres apparences. Or, la neutralité et la pureté n’existent pas. Un corps parle de lui-même et la danse est une occasion unique pour critiquer la neutralité d’un corps.
Le texte peut être un contrepoint dynamique très intéressant, au même titre que le travail du son et de lumière. Et quand la voix est engagée, il y a un tel éventail de possibilités de s’exprimer grâce à la respiration, au souffle, aux râles, aux pleurs ou aux mots. Ce qui m’importe, c’est de montrer le corps comme un corps humain. Créer, partager une humanité collective. Je suis intéressée par le fait de raconter des histoires et de parler des conditions sociales et politiques dans lesquelles nous vivons. Le texte me permet cela. Je veux que ces deux langages, mouvement et texte, soient toujours en train de se heurter, de se frictionner.
Dans quel espace nous invitez-vous ?
C’est un espace psychique, un espace de récupération et de dispersion de la mémoire. Ce n’est pas un espace surdéterminé ou catégorisé. Et je ne suis pas une narratrice fiable ! Je vous invite dans ma chambre, mais ce n’est pas ma chambre, dans une cour de récréation, dans le ciel, dans l’espace de mes rêves. Dans ce paysage, je vous invite à ouvrir votre propre espace psychique.
Je me pose la question des stratégies de vie dans notre propre corps après avoir subi la violence. Je souhaite vous inviter dans un espace illimité dans lequel chaque fois que l’on pense avoir trouvé un point d’appui, celui-ci disparaît, de sorte qu’on doive s’accrocher à autre chose. Dans Bronx Gothic, on est dans une phase psychique très complexe où une personne essaie de maintenir un corps protégé tandis que le corps blessé continue d’exister. Vous êtes dans son espace à elle, celui du personnage qui essaie de se réinventer avec toutes ses mémoires.
Pourquoi et comment avez-vous transmis ce solo à Wanjiru Kamuyu ?
Avant la pandémie, le Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles voulait programmer la pièce, tandis que pour moi, c’était fini, je ne pouvais plus jouer Bronx Gothic. J’ai alors pensé à la chorégraphe et danseuse Wanjiru Kamuyu. Puis, il y a eu la pandémie, tout s’est passé par Zoom. C’est mon partenaire et collaborateur Peter Born qui a travaillé avec elle.
Bronx Gothic étant écrit et performé par moi-même, je souhaitais que Wanjiru trouve ses propres personnages à l’intérieur d’elle, qu’elle rencontre la pièce à sa manière. Je ne voulais pas intervenir et je ne me suis jamais sentie prise par le mythe de la supériorité ou du contrôle sur son propre travail. Ça, c’est la maladie de la suprématie blanche. À ce jour, je n’ai toujours pas vu Wanjiru sur scène. Cela reste un mystère, c’est à la fois très intéressant et très excitant !