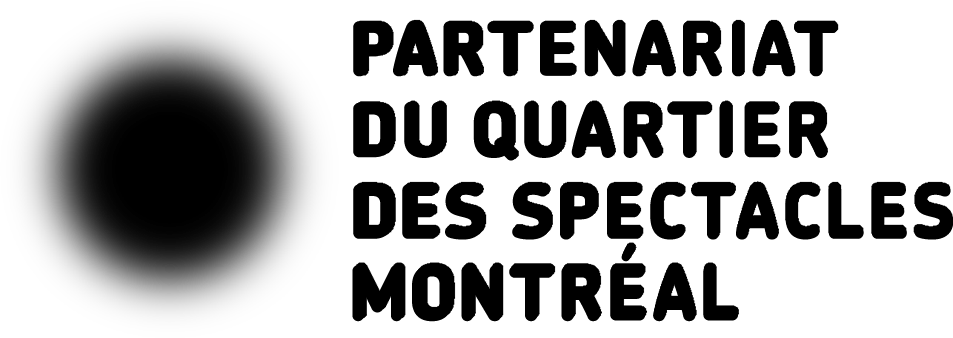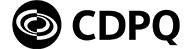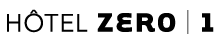Parlez-nous de la genèse de ce projet et des défis entourant l’adaptation du volumineux roman de Mohamed Mbougar Sarr au théâtre.
Aristide Tarnagda : L’écriture de Sarr convoque de la complexité et c’est ce que j’aime beaucoup. Elle habite les hommes et les femmes de son continent par sa beauté et sa justesse. Elle est à la fois incisive et crue, profonde et ancrée dans les problématiques africaines et mondiales. En cela, elle nous restitue notre humanité en nous replaçant dans l’universel.
En 2020, j’ai adapté au théâtre le premier roman de l’auteur, Terre ceinte. Je voulais initialement proposer au FTA une traversée de son œuvre par le biais des figures féminines de ses romans, qui me touchent beaucoup. Mais nous avons finalement choisi de partir d’un texte ancré dans l’actualité.
Dans un entretien accordé à France Culture, les griots et hommes de cinéma Dani et Sotigui Kouyaté affirmaient que « L’Afrique ne sait plus écouter ses vieux ». Que pensez-vous de cette déclaration et qu’y a-t-il à ce sujet dans La plus secrète mémoire des hommes ?
A.T. : On y retrouve tout d’abord la mémoire. Mohamed Mbougar Sarr évoque le tragique destin d’Yambo Ouologem [premier écrivain africain à recevoir le Renaudot en 1968, avec Le devoir de violence, avant d’être accusé de plagiat], qui a été très peu célébré et dont l’œuvre a été enterrée rapidement. Tout le mérite de Mbougar Sarr est de ressusciter cette histoire pour qu’elle devienne une partie du patrimoine des Africains, mais aussi de l’humanité. Je pense que La plus secrète mémoire des hommes interroge la transmission au sein d’une Afrique contemporaine où le quotidien est assailli par l’information et l’obsolescence.
Et ce qui a trait à la mémoire elle-même et à la citation de Kouyaté, je pense que les vieillards ont perdu une place importante dans nos sociétés. Ils étaient des relayeurs, des ponts du savoir. C’est en ce sens que l’art joue un rôle important dans la remise en cause et la naissance de nouveaux imaginaires. N’oublions pas aussi qu’il y a encore toute une société rurale, paysanne, qui existe ici, et je ne dis pas cela d’une manière péjorative. Les savoirs de ces gens et des ancien·ne·s sont toujours utiles.
Cette remarque au sujet des milieux ruraux nous ramène à Pier Paolo Pasolini et à son commentaire : « Le théâtre devrait être ce que le théâtre n’est pas. » Qu’évoque en vous cette boutade ?
Odile Sankara : Pasolini est quelqu’un que j’ai joué et qui m’a portée. Il était très ancré dans la culture qui était la sienne et dans la tradition populaire. Il prenait en compte dans toute son œuvre — littéraire, cinématographique — les destins fragiles des classes défavorisées. Et pas seulement en Italie. Il s’intéressait aux questions liées à l’Afrique aussi !
Et donc, à mon avis, le théâtre doit avant tout être en phase avec sa société et son temps. Il doit essayer de donner du sens et de la beauté. Le théâtre doit, par l’entremise du geste créatif, redonner de la vie et de l’espoir tout en interrogeant le monde. Quant à ce qu’il ne devrait pas être, c’est cette espèce de version piégée de la géopolitique contemporaine… On doit se dépouiller totalement de cette question politique. Le théâtre doit être garant de la mémoire collective et de l’histoire.
A.T. : Le théâtre populaire — pas au sens de « vulgaire » — doit appartenir au peuple. C’est un lieu de fraternité, de communion, où l’on se met au monde à travers sa langue, ses mythes, ses histoires, ses récits. C’est un lieu de maternité, une caisse de résonnance. Et c’est ce qu’on essaie de faire aux Récréâtrales.
Pour revenir à Pasolini, le théâtre devrait, à mon avis, être un lieu où l’on crie, mais aussi où l’on murmure. Les gens doivent se mélanger et non s’exclure. Pour parler comme Édouard Glissant, le théâtre est un lieu du « tout-monde ».
Mohamed Mbougar Sarr a évoqué la notion du « temps assassin », celui qui crève en nous l’illusion que nos blessures sont uniques. Il ajoute que c’est dans cette impasse que la littérature a une chance de naître. Qu’en pensez-vous ?
O.S. : J’aime bien cette expression, « temps assassin », parce que c’est le temps qui nous définit à travers ce que nous portons, à travers les contingences et les vicissitudes qui nous fragilisent. Or, le temps qui nous fragilise nous permet aussi de prendre conscience de notre destin, de le porter.
Comme on dit dans la culture africaine, c’est le temps qui fait la sagesse. On peut également penser à « l’usure du temps » : il nous use et nous grandit à la fois. On peut porter tous les discours vertueux aujourd’hui, mais ce n’est pas le présent qui est important, c’est la durée ! Quand les difficultés arrivent, que le vent souffle et qu’on vacille, on peut enfin voir si l’on a porté avec force et beauté nos vertus et nos idéaux.
Depuis la chute de Blaise Compaoré en 2014, le théâtre semble revivre au Burkina Faso. Odile, vous avez affirmé qu’il est même devenu « la première tribune politique du pays ». Quel type de risque implique cet engagement ?
O.S. : Je l’affirme et le réaffirme ! Pour moi, c’est la seule tribune qui reste dans un rapport basé sur la vérité. On ne peut pas tricher avec le public. On est mis à nu, on est dans un rapport de vérité qui interpelle nos différentes consciences. C’est en cela que je prétends que le théâtre est la première tribune politique. Après la chute de Compaoré au Burkina, différents secteurs ont été fragilisés à cause de son long règne et de sa mauvaise gouvernance, mais le théâtre est resté debout malgré tout. Il a su apporter de la vie, de la beauté, de la lumière, du rêve.
Cela dit, en ce qui a trait au risque encouru, je crois que la vocation de l’artiste — et c’est notre engagement — est bel et bien de prendre des risques. Si l’on ne prend pas de risques, les choses ne vont pas de soi. C’est l’engagement qui fait advenir les choses. Je crois que le pays, notre pays, a intérêt à écouter ses artistes ainsi qu’à nous écouter et à composer avec nous !