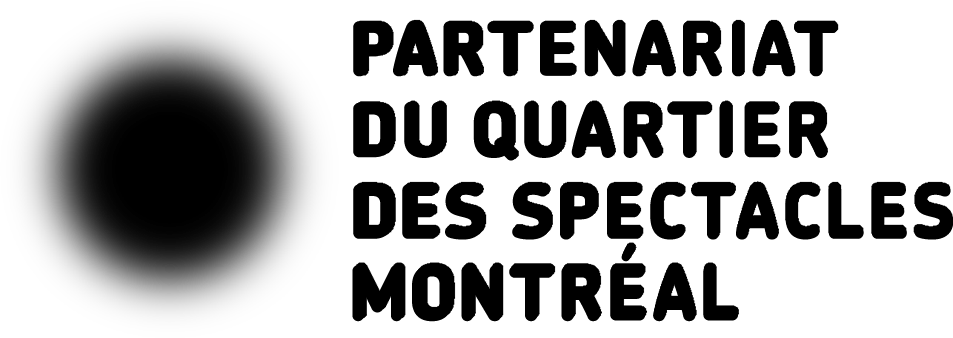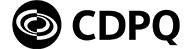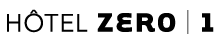En quoi la pièce Re:Incarnation s’inspire-t-elle de la spiritualité yoruba, votre ethnie d’origine ?
Je suis né au Nigeria, à Lagos, une ville cosmopolite, énergique et capitaliste qui ressemble à une version africaine de New York. La spiritualité yoruba n’y est pas très présente, il faut aller dans l’arrière-pays pour la trouver. Je m’y suis intéressé après avoir pris conscience que la race n’avait jamais fait partie de mes conversations au Nigeria. Nous sommes plus de 200 millions de personnes noires, mais c’est en voyageant que j’ai réalisé que j’étais noir. La négritude est une construction qui existe seulement en présence de la blanchité.
En quittant ce lieu où j’étais le centre du monde et de moi-même, où j’agissais selon mes propres intuitions, espoirs, ambitions et traumatismes, j’ai découvert, en faisant des tournées en Amérique et en Europe, que les autres avaient ce besoin constant de projeter des questions d’identité sur moi. J’ai éprouvé une sorte d’envahissement et j’ai eu besoin d’air. J’ai eu besoin de me resituer, de retourner vers mes origines, vers la spiritualité yoruba qui est à la base de ce que je suis. La philosophie yoruba conçoit le temps comme cyclique et non pas linéaire. Le futur et le passé ne sont pas en conflit. C’est intéressant pour l’art contemporain, parce que « contemporain » signifie « avec le temps ».
Tout mon travail prend son sens dans la compréhension du temps. Je n’invente pas, je ne fais que raconter l’héritage derrière moi, ce qui a été fait avant moi. Contrairement à la pensée chrétienne, la philosophie yoruba croit à la réincarnation, laquelle abolit la distance entre l’espace de la vie, celui des ancêtres disparus et celui des gens à naître, qui appartiennent au monde spirituel. La pièce est inspirée par ces trois espaces qui cohabitent en même temps : l’espace de la vie, l’espace spirituel et celui des ancêtres. Ce sont différentes manières de parler de réincarnation : naissance, mort et renaissance.
Un des chapitres de votre pièce se déroule dans le monde des morts. Quelle est la particularité de ce monde dans la culture yoruba ?
Les Yorubas ne pensent pas que la mort est une finalité. Ce n’est pas un espace de peur, ni une fin ou l’apocalypse, comme on se la représente en Occident. Pour nous, la mort est une occasion de renaître, de la même manière qu’après un traumatisme, nous cherchons à éviter l’expérience traumatique en nous créant une nouvelle fiction. Nous disons qu’il n’y a pas de réussite sans échec, sans rupture. La mort est une transition vers laquelle on peut accompagner quelqu’un, un processus en soi.
Quand je me suis intéressé d’un point de vue artistique à ce que veut dire « traverser » l’état de mourir, la mort était un concept, jusqu’à ce que nous perdions Love Divine qui interprétait un des personnages principaux de la pièce. La mort n’était plus abstraite, mais tangible, et pour guérir, on a voulu l’inviter avec nous. La lumière rouge sur scène fait référence à sa couleur de cheveux.
Il y a 10 interprètes sur scène, mais pour moi, ils sont 11, avec sa présence invisible. On a choisi de ne pas remplacer la scène qui était l’espace de son solo. On utilise ce moment pour l’inviter chaque soir et intégrer sa présence à la pièce.
La pièce est une rencontre entre l’énergie des rythmes d’hier et la jeune génération d’interprètes nigériane ?
Je me suis intéressé à la génération transitoire entre les milléniaux et la génération Z, connectée sur les médias sociaux, qui créent une sorte d’uniformité dans la culture, laquelle finit par effacer leur individualité. Cependant, je me suis rendu compte qu’il y avait une conversation entre les jeunes des différentes villes africaines au sujet de l’esthétique, de la musique, de leurs codes vestimentaires, de leurs styles de danse, etc. À cause des médias sociaux, ils et elles apprennent les un·e·s des autres d’une manière vivante à remixer, à remodeler.
Dans la manière d’utiliser le corps dans des expressions multiples, les mascarades, le maquillage, les costumes, le choix de la scénographie, la gestuelle, les mimiques, les jeunes réincarnent les gestes et codes du passé sans le savoir. La danse a cette capacité, après une longue amnésie, de se souvenir grâce à une mémoire corporelle, en utilisant des codes contemporains. Nous avons recruté presque tous les performeurs et performeuses du spectacle par Instagram, qui se filmaient avec leurs téléphones. J’en ai choisi une trentaine et je les ai accompagné·e·s dans un processus de conscientisation.
Pour moi, il y a trois niveaux de conscience : ce que tu sais que tu sais, ce que tu sais que tu ne sais pas et ce que tu ne sais pas que tu sais. Leurs corps savaient des choses qu’ils et elles ignoraient et je voulais les emmener à en prendre conscience, à revenir dans le temps, pour ensuite imaginer un autre futur. Pour les Yorubas, la performance rejoint le souvenir, et la composante essentielle du souvenir, c’est la guérison. Être capable de guérir, faire des ponts entre l’ici et l’ailleurs, entre hier et aujourd’hui, et rétablir l’harmonie et l’ordre pour pouvoir passer à l’étape suivante, cela rejoint l’idée de la réincarnation.
J’ai invité les interprètes à des exercices de mémoire corporelle afin de trouver leur propre langage original. Quand on est solide avec soi-même, on peut avoir un grand pouvoir de groupe.
En quoi l’Afrique d’aujourd’hui est-elle une inspiration pour vous, pour cette pièce en particulier ?
Je regarde le continent africain comme un laboratoire pour l’humanité. Nous avons connu la course aux ressources naturelles, l’histoire traumatique, les migrations humaines, l’exploitation des corps, la destruction de l’éducation, de la spiritualité, des structures politiques et des institutions, et nous avons vécu des événements extrêmement violents comme le colonialisme, l’esclavage, l’apartheid, le néo-colonialisme, en plus des guerres internes, des dictatures, des guerres civiles et des génocides.
C’est le continent où 65 % de la population n’a pas 30 ans. On y trouve aussi l’énergie créative, la joie, la volonté de vivre, de réécrire le passé et de se souvenir du futur.
Si les Africains et les Africaines ont pu traverser toutes ces expériences et conserver une joie de vivre, c’est qu’ils et elles ont sûrement quelque chose à nous apprendre. Je peins ce que je vois sur le continent africain sans jugement. Les interprètes nous apportent ce que leurs corps sentent et ont à dire sur le monde d’aujourd’hui.