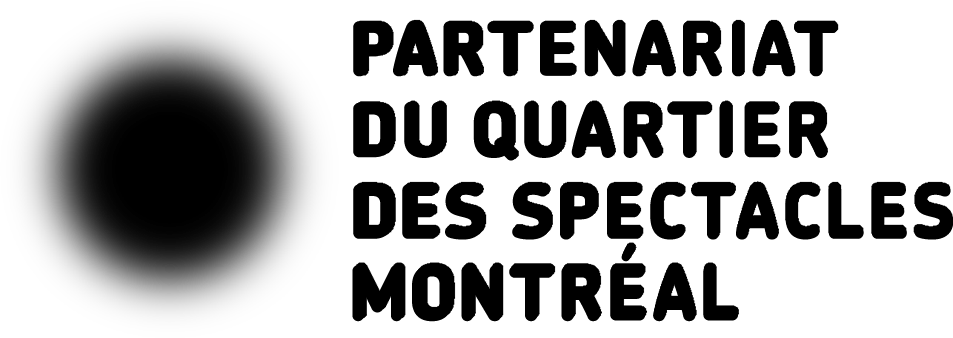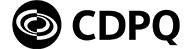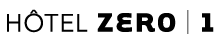Vous vous définissez comme une « personne collective ». Que peut nous apprendre cette affirmation sur votre posture d’artiste ?
Je suis formée par les rencontres que je fais. Tellement de choses me traversent. Je ne peux pas séparer ce que je suis comme artiste de ce que je suis comme citoyenne du monde et du Brésil. Pour moi, une personne collective est un être en collectif. C’est une définition de la démocratie. Le collectif n’est pas une théorie, une pensée ou une esthétique. C’est un agir : une action qui se travaille et se met en pratique. Ça demande d’être à l’écoute, de créer de l’espace pour les autres, de générer des rencontres ou encore de former des alliances (pour reprendre l’expression de Donna Harraway) avec des gens qui pensent différemment de soi dans des lieux où les artistes ne vont généralement pas.
C’est d’ailleurs pourquoi je me suis rapprochée il y a 20 ans de la favela de Maré pour y créer un centre de création et une école de danse. Je tente de mettre en pratique mes responsabilités en tant que femme blanche cisgenre de classe moyenne. Pour moi, il s’agit surtout d’accepter les différences, de les intégrer, de créer ensemble, mais pas dans une optique autoritaire comme cela arrive beaucoup dans les rapports nord-sud.
Encore aujourd’hui, aux yeux du monde, nous sommes la vision que le Nord a de nous. Pourtant, nos savoirs sont indispensables pour la suite du monde. Les peuples indigènes du Brésil mettent en pratique des savoirs écologiques depuis des années. Ces savoirs ancestraux sont là, à portée de main, mais complètement ignorés. Quand je parle d’un mouvement vers l’autre dans sa différence, je parle surtout d’un mouvement de déplacement, d’un décentrement.
Cette pratique du collectif s’incarne sur scène à travers, notamment, le motif chorégraphique de la vague, le déferlement ininterrompu des corps et de leurs étreintes. Quels types de coprésences ce mouvement vous permet-il d’explorer ?
Tout comme la vague, la pratique du collectif est un travail qui ne finit jamais, qui ne s’arrête jamais, car il est toujours à refaire, à réexplorer, à recommencer. Il en est de même pour le travail des figures à partir des couvertures : non seulement cela exige un travail de force, car c’est très lourd à porter, mais la matière textile ne trouve jamais pleinement sa forme, elle se fait et se défait constamment.
Sur scène, les interprètes doivent porter toutes ces couvertures jusqu’à la fin — aucune ne doit être laissée derrière et chacun·e partage cette responsabilité. Pendant les pénuries d’eau en temps de crise, les gens font la chaîne pour se passer le seau d’eau de main en main. Une part de cette image s’incarne ici. C’est ensemble que toutes et tous transportent ces couvertures de l’avant vers l’arrière, et ce, du début jusqu’à la fin.
Comment le modèle de la courtepointe et ses déclinaisons — tissus, couture, tissage, maillage… — a-t-il nourri votre processus de création ?
La rencontre collective est pour moi un travail de broderie et je me demande toujours comment tisser quelque chose ensemble. Ici, c’est moi qui tisse. Les interprètes me donnent de la matière, m’aident à tisser, mais j’ai la responsabilité du tissage : je suis la couturière. Dans Encantado, nous utilisons des couvertures très bon marché aux motifs variés et aux couleurs vives. J’aime cette possibilité de trouver de la beauté dans des matériaux triviaux. Créer des figures visuelles à partir d’une matière ordinaire.
La première image du spectacle est faite de ce rouleau de couvertures tout au fond qu’on déroule ensemble. Je voulais travailler avec cette image du serpent sacré issue de la cosmogonie indigène qui ouvre tous les chemins de création. C’est le schéma de la jiboia, qui symbolise la guérison, la renaissance, le savoir holistique et la connaissance de ce qui nous lie d’un point de vue cosmique comme microscopique.
Quels liens faites-vous entre ces éléments cosmogoniques et le choix de présenter des extraits de chansons du peuple Guarani Mbya ?
J’ai entendu pour la première fois ces chants durant une manifestation pour la reconnaissance de leurs terres ancestrales. Dans cette musique, aux côtés des maracas qui sont les instruments traditionnels des rituels indigènes au Brésil, on retrouve aussi la présence d’instruments à cordes issus de la colonisation portugaise. Et on entend une sonorité médiévale contemporaine. C’est une musique dont les sons et les rythmes ont voyagé et ont été mixés chez nous. Ce maillage illustre très bien mon travail : un espace d’évocation pluriel pour les gens qui l’écoutent.