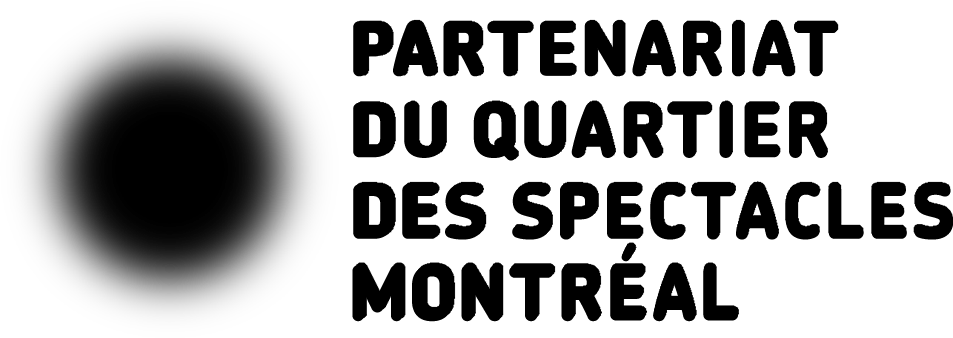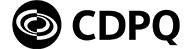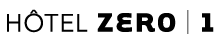Pierre Lefebvre, qu’avez-vous écrit au juste ?
P. L. : J’ai écrit un essai sur l’impact de la politique sur le corps, conçu pour avoir deux vies : une vie sur papier et une vie sur scène. Tout est parti d’un court texte qu’Olivier Choinière m’avait demandé en 2016 pour son second 26 lettres : Abécédaire des mots en perte de sens. Il m’avait confié la lettre L pour libéral — l’idée, pas le parti. Alors j’ai adressé ma lettre à Philippe Couillard, le premier ministre à l’époque. J’y abordais deux questions. Un : il n’existe pas d’endroit où lui et moi pouvons nous parler. Si tu n’as pas toi-même de pouvoir, toute conversation avec François Legault, Pierre Karl Péladeau, Jeff Bezos ou Alain Bouchard est concrètement impossible…
Deux : pour justifier ses mesures d’austérité, Couillard avait fait valoir qu’elles étaient nécessaires pour ne pas faire baisser le statut du Québec auprès des agences de cotation de New York, pour ensuite se réjouir du succès de sa stratégie. Qu’un premier ministre supposément souverain dans ses fonctions brime ses concitoyens pour obéir à des instances privées étrangères a soulevé chez moi la question suivante : comme citoyen, à qui me fait-on obéir ?
Par la suite, j’ai participé comme dramaturge au projet de Système Kangourou avec des adolescents intitulé le pouvoir expliqué à ceux qui l’exercent (sur moi); ce travail m’a fait revisiter la pensée de philosophes comme Hannah Arendt, Tocqueville, Montaigne, La Boétie et Rancière dans un cadre théâtral sous le signe de l’oralité.
De plus, au cours des années, des comédiens comme Alexis Martin et Sébastien Ricard, ou des metteurs en scène comme Dominic Champagne et Christian Lapointe avaient porté de mes textes non théâtraux à la scène, lesquels y acquéraient une dimension supplémentaire.
Benoît Vermeulen, quels sont les défis de porter à la scène une telle écriture ?
B.V. : Je ne connaissais pas vraiment l’écriture de Pierre lorsqu’il m’a proposé d’explorer la théâtralité de son texte au cours d’un laboratoire très libre. Et dès que j’ai lu Le virus et la proie, j’ai tout de suite perçu son potentiel théâtral. Cela dit, théâtraliser efficacement cette écriture pour qu’elle passe de la scène à la salle n’est pas évident.
La langue est dense, à première vue intellectuelle, mais dès que l’on se la met en bouche, elle investit le corps. Aussi, il fallait faire en sorte que le rapport entre la scène et la salle serve à établir un rapport de citoyen·ne·s à citoyen·ne·s. L’évidence de cet impact corporel nous a guidés. Avec les interprètes, il a d’abord fallu accomplir un travail de décorticage du sens. Nous avons passé parfois trois heures sur une seule page — ça, c’est jouissif ! — mais une fois ce travail fait, un phénomène étonnant se produit : le texte devient très facile à comprendre à l’audition, beaucoup plus qu’à la lecture. C’est d’ailleurs ce qu’a démontré la lecture publique que nous en avons faite l’an dernier au FTA.
Il fallait aussi dynamiser le texte, qui donne d’abord la fausse impression d’avancer régulièrement, et mettre en valeur ses contrastes et ses tensions : il n’y a pas de conflits internes, mais des allers-retours entre l’intime et le politique qu’il faut mettre en lumière. Il a fallu diviser le texte, l’attribuer. J’étais d’accord avec Pierre sur l’intérêt de démultiplier cette parole plutôt que d’en faire un monologue. Le fait d’avoir une distribution d’âge et d’origine diversifiés donne davantage de puissance au portrait de la déshumanisation quotidienne que porte le texte. C’est un phénomène qui affecte toutes les classes sociales, toutes les cultures. Et comme Le virus et la proie ne cesse de mettre en lumière un état de fait révoltant, il fallait aussi éviter le cynisme et la colère continuelle, qui aurait poussé les interprètes à jouer de façon enragée du début à la fin.
La pandémie a-t-elle influé sur le développement du spectacle ?
P.L. : La pandémie a créé un trou dans le travail, mais ce temps d’arrêt a provoqué un mûrissement au sein de l’équipe. À la reprise du travail, tout s’est naturellement déposé dans une sorte d’essentiel : incarner la parole en toute simplicité. Les interprètes sont arrivés là où ils doivent être : dans leur corps, pas dans leur tête.
B.V. : Cette idée de simplicité s’est encore davantage imposée pour la théâtralité du spectacle. Certes, il y a une scénographie, mais ce n’est pas un décor. Pour ce qui est des accessoires, des costumes, de la lumière, nous avons été à l’écoute de l’énonciation du texte par les interprètes et n’avons apporté — un à un — que les éléments qui, au fil du travail, nous ont paru nécessaires pour rendre le sens plus limpide.