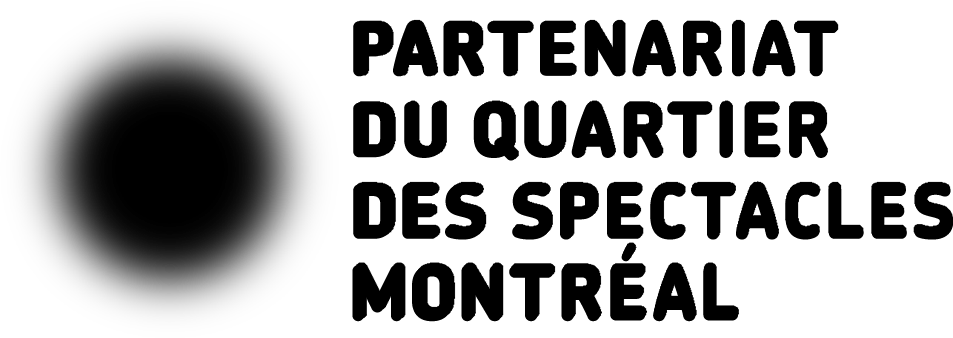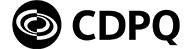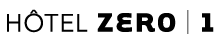Votre travail prend comme point de départ le corps en tant qu’archive. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet ?
Lorsque je pense au corps en tant qu’archive, cette anecdote me vient en tête : la façon dont vos cils se forment à partir des yeux résulte en partie de la façon dont vos ancêtres étaient positionnés par rapport au soleil. Cette idée d’une mémoire du corps me fascine. Comme beaucoup de danseur·euse·s, je suis persuadée que rien n’arrive dans le vide. Toutes les techniques qui m’ont été apprises et les différentes façons dont je conçois mon corps influent sur ma manière de danser et de créer. Même si une grande partie de ma formation « officielle » s’est faite en Europe et en Amérique, mes créations sont intrinsèquement imprégnées d’influences autochtones ; tout cela coexiste en moi. Et pour avoir accès à ce « dépôt », que l’on pourrait qualifier d’ontologique, je dois redéfinir ce qu’est une archive et les moyens de travailler avec ce matériau.
Dans Rinse, vous explorez l’idée du commencement, du début. En quoi cette notion vous intéresse-t-elle ?
Lorsqu’on cherche à définir certains concepts, on ressent très souvent le besoin de situer le commencement de quelque chose. Par exemple : le début des temps, le début du féminisme, de la colonisation, de telle ou telle religion, de telle guerre, etc. En tant que personne autochtone, cette notion de commencement résonne pour moi d’une manière particulière. En effet, l’idée même de l’existence des peuples autochtones arrive seulement au moment de la colonisation. Avant que les colonisateur·rice·s ne nous désignent ainsi, nous, les « autochtones australien·ne·s », qui sommes là depuis 65 000 milliers d’années, ne nous définissions pas comme des « personnes autochtones », mais simplement comme des « personnes ». On nous a attribué ce nom qui vient du grec ancien et signifie « issu de sa propre terre ».
Il m’est donc venu en tête que bien souvent, on ne conceptualise les choses qu’au moment où il faut les différencier d’autre chose.
Ça m’a beaucoup intéressée de comprendre comment s’articulent ces multiples commencements. Quand on se demande quelles sont les conséquences de l’impérialisme sur les gens, les lieux ou les corps, on pense à une dualité : avant et après. En réalité, je ne crois pas que les choses s’articulent ainsi. Le soi n’est jamais divisé aussi clairement, on est tous hybrides, multiples, à bien des égards. Dans Rinse, j’essaie de créer un mythe originel qui reflète cette multiplicité.
La partition textuelle occupe une place importante dans votre spectacle. Comment les mots se sont-ils imposés ?
Cette combinaison entre le texte et le mouvement, je l’ai explorée dans des œuvres précédentes, mais jamais de manière aussi approfondie. D’ailleurs, je ne pensais pas que je parlerais autant et il y a eu beaucoup d’allers-retours à ce sujet avec ma dramaturge et metteuse en scène, Mish Grigor. Mais une fois que j’ai accepté le fait que le travail allait dans cette direction, j’ai trouvé un moyen de travailler sur ces deux éléments : le physique et le textuel, et j’ai découvert comment les intégrer à ma façon. Ils se répondent l’un l’autre.
Les mots sont arrivés naturellement. Au début du processus, je tentais de reconnaître mes impulsions récurrentes comme danseuse et de voir d’où elles venaient. Par exemple : peut-être que je bouge toujours mes chevilles de cette manière parce que j’ai beaucoup dansé dans le sable dans ma vie ? Est-ce que ce mouvement extérieur de mon bras est une trace de cette pièce avec telle chorégraphe ? J’énonçais ces hypothèses à voix haute alors que je les dansais, que je les cherchais dans mon corps. Ce qui au début ne devait servir qu’à répertorier les mouvements est finalement devenu la matière même de la pièce. Ensuite, j’ai voulu bien sûr créer deux récits différents entre le corps et la parole en intégrant des interférences et des déviations entre les deux partitions.
Retour au spectacle