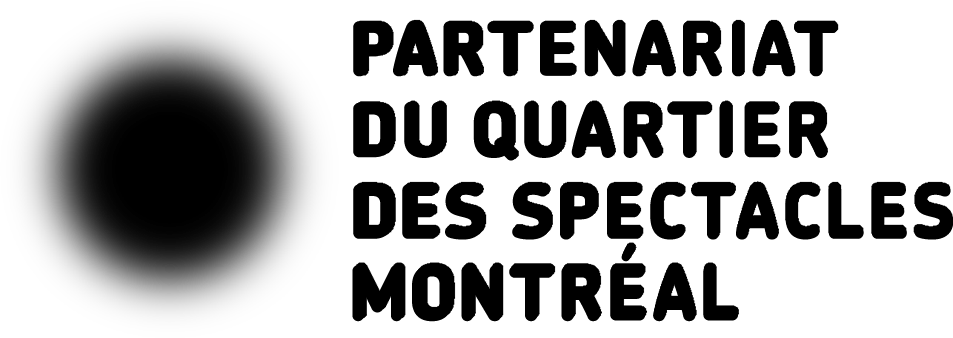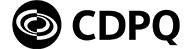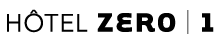Votre longue amitié avec l’artiste Waira Nina, du peuple Inga d’Amazonie en Colombie, est au cœur de l’œuvre en chantier que vous présentez dans cette édition du FTA. Qui est Waira et comment avez-vous tissé des liens ?
Waira est une leader autochtone d’un grand courage, une conteuse et une artiste interdisciplinaire. Son peuple vit dans le Caquetá colombien. La mère de Waira, Natividad Mutumbajoy, était une ainée très importante, qui a reçu le Prix international Linguapax en 2006 pour son travail de sauvegarde de la langue Inga. Leur famille a fait beaucoup pour la résurgence politique, culturelle et spirituelle de leur peuple.
La vie de Waira a été marquée par de grandes tragédies. Sa communauté s’est retrouvée au centre de plusieurs conflits armés, subissant beaucoup de violence. Son territoire a été ravagé par les paramilitaires, l’ancienne guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), d’autres groupes armés, les cultures illégales (coca, pavot, etc.), l’extraction minière, l’activité des compagnies internationales… Deux de ses frères, des leaders autochtones et des militants environnementaux, ont été assassinés.
J’ai rencontré Waira en 2003, alors que je faisais une maîtrise en études de la paix et en résolution de conflits internationaux au Pays basque. Waira avait été invitée par l’ONU pour faire une formation intensive sur le droit international autochtone, aux côtés d’autres leaders de l’Amérique latine. En 2009, je me suis rendue en Colombie pour participer à un festival. C’était l’occasion d’aller rendre visite à Waira. Nous avons fait une cérémonie, pendant laquelle sa famille a parlé de l’importance de créer des liens entre les peuples autochtones du Sud et du Nord, notamment en matière de protection des médecines traditionnelles, et m’a demandé de revenir avec d’autres personnes autochtones. En 2011, j’étais de retour pour une résidence de création, dans le cadre de laquelle Waira et moi avons débuté notre collaboration artistique. Depuis, nous nous sommes vues régulièrement.
Dans quels champs de pratique Waira œuvre-t-elle ?
Waira chante, fait des performances et déploie une pratique d’art sonore. Elle s’est aussi réappropriée la yako mama, un instrument de musique traditionnel des femmes Inga en carapace de tortue. En outre, elle écrit des récits. En ce moment, elle travaille sur un livre en Inga et en espagnol qui rassemble des histoires courtes inspirées de son enfance avec son père et ses grands-pères qui étaient des taita (des médecins traditionnels qui prodiguent la médecine ambiwaska).
Quelle place occupe le travail sur les sons et les langues dans vos pratiques respectives ?
Nous aimons toutes les deux collecter des sons, documenter la vie environnante et enregistrer les entrevues que nous menons avec les communautés, notamment avec les aîné·e·s.
Pour notre laboratoire au FTA, nous voulons pousser l’improvisation vocale plus loin et découvrir des manières de faire résonner nos langues et nos territoires. L’idée est de construire une forêt chantante. Nous collaborons notamment avec l’artiste sonore colombien Leonel Vasquez, qui crée des objets permettant de rendre audible ce qui est inaudible. Par exemple, grâce à des actuateurs, le chant sacré d’un·e aîné·e peut émerger d’un tronc d’arbre.
Le travail sur les langues, notamment l’anishinaabemowin, a toujours été présent dans mes pièces. Il y a une dimension tant politique que poétique dans le fait de faire entendre les langues autochtones sur scène. Avec Waira, notre langue commune étant l’espagnol, travailler en plusieurs langues est une nécessité. Sur le plan artistique, on va s’atteler à expérimenter des manières de faire coexister cinq langues – deux langues autochtones et trois langues coloniales – sur scène. Peut-être sera-t-il nécessaire de créer un langage sans mots.
Est-ce que pour cela que les couleurs sont si importantes dans votre processus créatif ?
Au début de notre collaboration, les outils dramaturgiques étaient inconnus de Waira. A émergé alors l’idée de travailler à partir de couleurs. Celles-ci constituent un formidable chemin dramaturgique, qui nous permet d’examiner le ressenti de chacune d’entre elles et de tisser un parcours, à travers lequel nos cosmovisions et nos savoirs respectifs se rencontrent.
Nous commençons bientôt une résidence dramaturgique à Espace GO en vue d’explorer tout le matériel que nous avons accumulé, avec notre collaboratrice principale Sarah Williams et notre dramaturge Yohayna Hernández González. C’est un processus qui entremêle du théâtre documentaire, de la performance, du travail vocal et sonore, de la vidéo… La performance qui en résultera correspondra à la forme plus artistique de notre collaboration, qui est centrée sur la création d’une plateforme d’échanges entre les peuples autochtones du Nord et du Sud.
Cette performance avec Waira fait-elle partie d’un cycle de création sur une thématique spécifique ?
Ce spectacle est en effet la deuxième partie d’un cycle de création sur l’amour, dans ses différentes formes et déclinaisons. Pour Neechemus, présenté à Espace GO en janvier 2023, j’avais réuni des femmes autochtones et noires de différentes générations autour des thèmes de l’amour, du plaisir, de la sensualité et de l’érotisme. Dans notre projet, Waira et moi nous penchons sur une autre facette de l’amour, celle de l’amitié.
Plus spécifiquement, nous sommes parties d’une première question de recherche : Comment être une bonne alliée, surtout dans ce contexte de relation entre une personne autochtone privilégiée du Nord, habitant ce territoire qu’on appelle le Canada, et une personne autochtone du Sud, dont le pays est dévasté par des compagnies minières et pétrolières canadiennes? Que veut dire être une amie, dans le sens profond de ce qu’est l’amitié ?