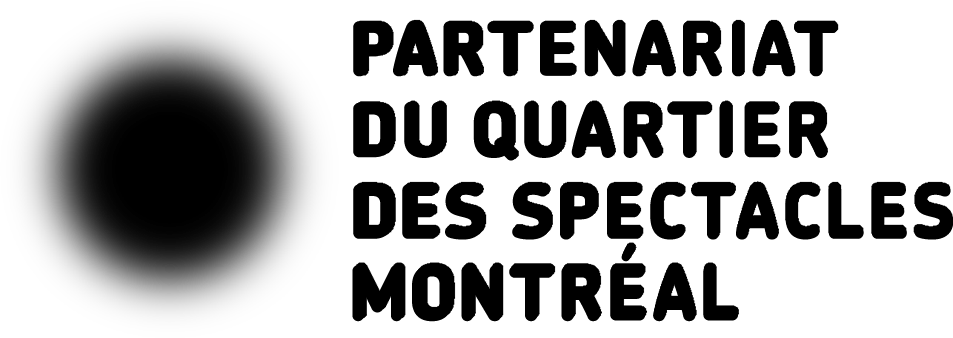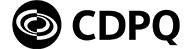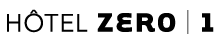Quel espace souhaitez-vous créer avec Survival Technologies ?
Kamissa Ma Koïta : Un espace circulaire où la joie nègre gagne. Cet espace me rappelle les arbres à palabres qu’on retrouve dans certains pays du continent africain et autour desquels on organise réunions de famille et assemblées du village pour régler divers conflits. C’est une forme qu’on retrouve aussi dans les cultures afro-américaines par la pratique des cyphers et des battles entre autres. J’y vois un motif de la culture afro qui se manifeste dans le contexte colonial, qui refait surface malgré l’oppression et qui rejoint une certaine mouvance afrofuturiste à laquelle j’associe le projet.
Elena Stoodley : Survival Technologies est un cercle d’expression pour les Afrodescendant·e·s basé·e·s en Occident, où les technologies ancestrales demeurées en nous peuvent rayonner malgré l’omniprésence des technologies coloniales.
Pouvez-vous me parler des technologies du spectacle ?
E. S. : La première technologie du spectacle, c’est la danse, outil de résistance et de passation des savoirs ancestraux par excellence. Elle libère et connecte les danseurs à une même fréquence. On l’utilise dans la création pour rivaliser avec cette autre technologie, l’intelligence artificielle, qui s’impose dans notre cercle. Développée par des personnes majoritairement privilégiées, l’IA reproduit les préjugés sociaux de ses créateur·rice·s tout en s’appropriant, dans un même geste, les propriétés intellectuelles des artistes noir·e·s. On retrouvera aussi des technologies comme le rassemblement, les vibrations, la chanson à répondre et la joie — l’expression d’une joie sans complexe.
K. M. K. : Pour moi, il est important de faire la distinction suivante : on n’approche pas la danse comme un divertissement ou une activité culturelle, mais bien comme une manière de célébrer les étapes de la vie et de communiquer avec les ancêtres, qui nous transmettent ce savoir incarné. En combattant l’intelligence artificielle par la danse, on souhaite contrer les systèmes capitalistes et néocoloniaux avec ce qui nous appartient, ce qui habite nos corps. J’aimerais beaucoup faire reconnaître ces savoirs ancestraux du continent africain comme sciences, au même titre que la médecine ou l’ingénierie occidentales.
À quoi aspirez-vous en dansant ? Comment la danse vous transforme-t-elle ?
K. M. K. : Je souhaite intégrer ma culture malienne en dansant. Retrouver les rites de ma famille qui y vit toujours et quitter cet « ici » canadien. D’une certaine manière, je cherche à me mettre dans une posture d’ancêtre du futur. Je voudrais laisser derrière moi les éléments occidentaux qui me pèsent. Je souhaite offrir le meilleur à celleux qui viendront après moi en me focalisant sur mon éthique de vie et la manière dont elle influera sur les générations à venir.
E. S. : Et pour ma part, je souhaite me réapproprier ma liberté. Au fil des années, je me suis rendu compte que je m’empêchais de bouger librement, parce que mon corps n’est pas standard. La danse guérit, alors pourquoi me priver de cette médecine ? En dansant, je me donne le droit d’imaginer un futur qui soit le plus flamboyant possible, en me rappelant toujours que je suis, le rêve et la joie de mes ancêtres. Cette joie, on souhaite la mettre en pratique maintenant et la conserver pour les générations futures.
Survival Technologies n’est pas votre première collaboration avec PME-ART. Quelle relation entretenez-vous avec ce groupe interdisciplinaire ?
K. M. K. : J’ai d’abord découvert la compagnie en assistant à son spectacle Un sentiment d’authenticité : mode d’emploi. Je me suis dit : « Iels sont ben bizarres ! Faut absolument que je traîne avec elleux. » Et depuis, on travaille ensemble. Je suis constamment reconnaissante de ce que Jacob et Sylvie nous offrent et de la manière dont tous deux participent à notre qualité de vie. On entretient un lien de confiance et un respect mutuel qui va bien au-delà du lien professionnel.
E. S. : Complètement d’accord. Et pour ma part, j’ai d’abord été invitée par la compagnie à participer au projet Toutes les chansons que j’ai composées en 2016, il y a déjà sept ans. Dès les tout débuts, j’ai été surprise par leur « antifragilité ». C’est-à-dire que je ne me retrouvais pas devant la fragilité blanche à laquelle je suis habituée dans le milieu artistique montréalais. Ce rapport antifragile m’a fait prendre conscience que j’ai tout à fait le droit d’être ici, sans aucun complexe.