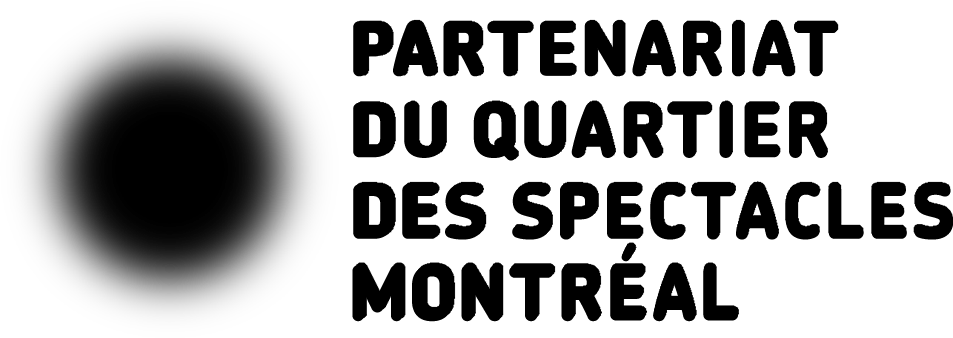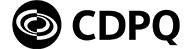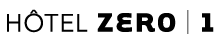Nehanda est un esprit ancestral vénéré, mais c’est aussi une histoire de résistance et d’injustice. Avez-vous travaillé d’une manière particulière la création et la présentation de cette pièce pour honorer l’histoire du peuple shona ?
Toute mon œuvre et ma philosophie sont axées sur l’Afrique. Maintenant que je me suis partiellement réinstallée en Afrique, je suis reconnaissante d’avoir l’occasion d’y être présente de manière plus utile, au lieu de seulement m’y sentir chez moi. C’est un sentiment que je peux partager avec d’autres dans cette communauté et avec le monde entier, où je peux à tout le moins diffuser une grande partie de ce que nous faisons dans l’univers austral.
Pour créer Nehanda, j’ai eu besoin d’une immersion bien plus intense qu’un simple retour en Afrique. Au Zimbabwe, je travaille avec un maître culturel et spirituel, soit, dans mon contexte, un svikiro. Les svikiro sont nés pour détenir et transmettre la culture, que ce soit par le langage, le mouvement ou les sons, et la spiritualité. Tous les membres de la compagnie ont à cœur de travailler à partir des diverses manières dont l’éducation occidentale est fermée à l’état d’être propre à l’africanité, et de les comprendre. Je suis consciente de tout le travail à faire dans cette quête de la décolonisation des connaissances et, parce que Nehanda est l’esprit du pays, il n’était pas question pour moi d’aborder un sujet de cette importance sans le soutien d’autres personnes qui en savent plus long que moi sur la question.
Nehanda est présenté comme un opéra. Pourquoi ?
Il n’y a pas de réponse facile, parce que le désaveu qui me vient de spectateurs pour qui l’opéra évoque nécessairement Puccini ou Wagner est assez véhément et que je me suis épuisée à lutter contre cette attente. Est-ce indispensable qu’une œuvre soit le fait d’un compositeur, d’un chanteur et d’un concepteur célèbres pour être considérée comme un opéra ? Je refuse de m’expliquer sur l’histoire de l’opéra, parce que, en vérité, un opéra est tout bonnement une histoire racontée de manière sonore. Et c’est ce que nous faisons.
Je ne souhaite pas travailler avec un compositeur parce que l’œuvre est le résultat d’un travail collectif et que le son, qui a besoin de s’amplifier, jaillira de nous. L’une des raisons pour lesquelles je persiste à présenter Nehanda comme un opéra tient au fait que je demande au public, un public pensant, de penser. Nehanda émerge dans le sillage d’Einstein on the Beach (Philip Glass, Robert Wilson, 1975) ; certains pourraient refuser de le considérer comme une œuvre musicale, mais, à mes yeux, c’est de la pure ignorance. Nous apportons une instrumentation inédite au monde de la musique, des façons de vocaliser qui sont très techniques et, si les gens sont assez généreux, ils peuvent se glisser dans cet espace opératique en gardant le cœur et l’esprit ouverts. Refuser de voir Nehanda comme un opéra ne profite à personne.
Il existe en anglais une expression politiquement incorrecte qui pourrait se traduire ainsi : « Avant que le rideau tombe, il faut entendre la grosse dame chanter. » J’ai décidé que l’Afrique serait la grosse dame.
En tant que créatrice, comment souhaitez-vous que le public reçoive Nehanda ?
La meilleure manière de recevoir une œuvre, quelle qu’elle soit, est d’accepter l’invitation et de s’abandonner. Nous sommes alors en communion les uns avec les autres et nous participons à de multiples dialogues : entre les corps dans leur proximité mutuelle, entre le divin et les humains sur Terre, entre l’architecture de l’espace et les gens qui l’habitent. Si vous ne comprenez pas les langues parlées dans Nehanda, vous pourriez croire que l’œuvre est en anglais, et pourtant elle ne l’est pas. Pour moi, Nehanda est intraduisible. Je veux que la fréquence sonore soit la langue. Si vous pouvez écouter la fréquence, vous pouvez la ressentir, et si elle vous va droit au cœur, alors vous l’avez entendue. Le public est intelligent et trouvera des moyens de s’inscrire dans ce dialogue complexe.
Durant les représentations de Nehanda, nous demandons au public de se situer dans le même espace et au même niveau que les artistes. Ensemble, nous occupons l’espace en tant qu’êtres humains. Il arrive souvent que nous ne soyons pas autorisés à présenter le spectacle dans ces conditions, mais c’est une nécessité. Nous devons nous trouver dans le même espace, au même niveau. Le ressenti est concret et, en refusant de céder à la raison en produisant une œuvre pertinente du fait que les gens comprennent les mots prononcés, nous avançons vers la décolonisation de l’espace théâtral. À mes yeux, la manière de faire occidentale, classique, ne permet pas de se présenter soi-même d’une manière acceptable. Nous formons une communauté et je préfère ne pas reproduire la hiérarchie.