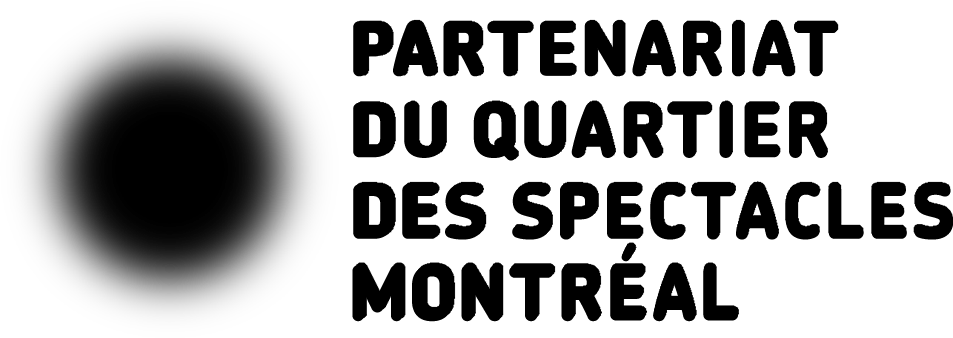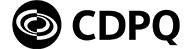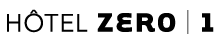Multitud est une mise en application de concepts philosophiques, notamment reliés à la tension entre le collectif et le personnel. D’où émerge cette inspiration ?
Je suis de ces artistes dont les créations s’enchaînent, naissent les unes des autres. Multitud vient d’une recherche que j’avais faite sur la mémoire récente et la dictature qui a marqué mon pays. Venant d’une famille très engagée politiquement, il y a dans mon entourage des personnes exilées, disparues, en prison… Je suis aussi d’une génération charnière dont la façon d’envisager le futur a été structurée par cette réalité politique et dont le monde a changé au moment où elle pouvait agir. De cette discontinuité, de toute une pensée devenue obsolète, émergeait la quête d’un collectif à inventer. Avec Multitud, je voulais m’interroger sur la façon d’être ensemble tout en étant différent·e·s parce qu’on sortait d’une période fondée sur l’homogénéité, sur l’idée que la force venait de l’union, qu’ensemble, nous pourrions changer le monde. Mais comment obtenir quelque chose en commun si nous sommes toustes différent·e·s ?
Je me demandais aussi ce qui se passerait avec une œuvre si j’en changeais l’échelle en augmentant le nombre d’interprètes. J’ai commencé mes explorations en m’inspirant de philosophes italiens contemporains qui ont repris des réflexions de Spinoza sur la multitude. Par exemple, Paulo Virno dit que le langage de la multitude est basique, non codifié. Celui de la pièce est très simple : marcher, courir, rire, tomber… Pas besoin d’être initié·e pour y participer.
L’œuvre remet aussi en question les relations de pouvoir en misant sur l’auto-organisation du groupe avec des prises de décisions individuelles qui servent un objectif commun…
Oui, ce n’est pas une chorégraphie de masse, mais bien une danse de relations. Les interprètes savent quelles actions sont à effectuer ; ils et elles décident dans l’instant de les débuter ou de les arrêter. Il n’y a pas de leader, mais une présence à l’autre, une écoute et une grande ouverture. Il s’agit de se risquer ensemble à occuper le présent. Chaque personne est responsable d’elle-même, de son corps, de ses choix. Et si je commence les répétitions comme leader, je me retire progressivement parce que c’est un exercice d’autonomisation. Pour moi, ça demande de lâcher toute forme de contrôle pour laisser arriver les choses. Et c’est toujours aussi surprenant que merveilleux de voir comment émerge cette autonomie. Je suis toujours étonnée de la façon dont les gens négocient avec les contraintes, dont ils s’approprient l’œuvre. Toutes sortes de personnes l’ont déjà dansée. Il y a eu une dame de 86 ans, une autre presque aveugle, une autre en fauteuil roulant… Toutes ont toujours trouvé leur chemin dans l’œuvre et avec le soutien du groupe. C’est beau à voir, très émouvant.
L’exercice de lâcher-prise vaut pour moi autant que pour les interprètes. L’idée fondamentale est de toujours laisser la porte ouverte aux choix individuels. C’est aussi une invitation à rompre la norme sans mettre le collectif en danger. C’est très difficile de pratiquer cette ouverture, c’est un exercice sur soi important. Plus largement, l’ouverture implique que n’importe qui peut arriver et prétendre aux mêmes possibilités que moi. C’est ce qui rend la question de la migration si délicate. C’est aussi ce qui rend la pièce politique. Elle propose un dispositif dans lequel les gens doivent trouver comment faire pour se rencontrer.
Quelles couleurs particulières prend Multitud selon ses lieux de création et quels enseignements en avez-vous tirés depuis la création, en 2013 ?
J’ai traversé une crise à un moment où je me disais que si cette œuvre ne mourait pas, je devrais la tuer moi-même pour m’en libérer. Et j’ai compris qu’il s’agissait plus d’une pratique, que d’une œuvre ; que cette pratique était reliée au temps personnel et social et que, par conséquent, elle ne pouvait pas mourir. Au-delà des références philosophiques initiales, son vocabulaire est commun à tous les êtres humains, même si elle prend des formes très différentes en Amérique latine, dans les pays arabes, à Cuba, en Belgique ou en France.
Pour moi, c’est une possibilité incroyable de connaître le monde par le prisme de personnes de différentes sociétés. Ma fascination pour les différences est presque une dépendance. Le nombre de points de vue possibles sur une même situation est si grand que je m’efforce de cultiver un état de non-savoir, de ne jamais présumer de ce que vont faire les gens, de simplement observer ce qui arrive. Ça élimine pour moi la nécessité de lire l’autre, de le situer. Mon regard est constamment renouvelé.